- MICROCHIRURGIE
- MICROCHIRURGIECe sont les ophtalmologistes et les oto-rhino-laryngologistes qui ont commencé à utiliser le microscope en chirurgie, pour la dissection de zones très délicates. Mais, bien que les principes de la suture vasculaire aient été posés par Alexis Carrel en 1902, il a fallu attendre les années soixante pour voir s’établir une conjonction entre cette technique et l’usage du microscope. Depuis cette époque, de nombreux chirurgiens se sont intéressés au problème des sutures microvasculaires, les techniques d’intervention ont été perfectionnées et atteignent aujourd’hui une grande fiabilité. Bien que, dans certains cas, les moyens de grossissement simples, tels que la loupe, soient utilisables, la plupart préfèrent utiliser le microscope dès que le diamètre de la structure descend au-dessous de 1 mm ou 1,5 mm.Pendant des années toutefois, la microchirurgie était demeurée une technique de laboratoire, permettant de nombreuses transplantations expérimentales du cœur, du foie, du rein chez le petit animal et servant ainsi à la formation technique de jeunes chirurgiens. On peut considérer que la première application clinique pratique de la microchirurgie vasculaire a été, en 1965, au Japon, la réimplantation d’un pouce. D’autres ont suivi, en Chine, puis en Australie, au Japon de nouveau et puis en Europe. Une étape importante a été franchie en 1972 lorsque, au Japon, a été transplanté avec succès le premier lambeau cutané libre.Les techniques en matière de transfert libre se sont multipliées et l’on a pu en voir apparaître un assez grand nombre, telle la suture des lymphatiques, des nerfs de petit calibre et les transplantations d’orteils, de muscles, d’os.La microchirurgie s’est progressivement étendue à des domaines divers de la chirurgie: gynécologie, neurochirurgie, chirurgie vasculaire, ophtalmologie, chirurgie réparatrice, urologie, etc.Le matérielIl faut tout d’abord bien s’entendre sur la nature de la microchirurgie vasculaire. On peut se demander, en effet, si elle est définie par le diamètre du vaisseau intéressé (un diamètre de 2 mm paraît être une bonne limite: les artères du poignet en font souvent 3 ou 4). En réalité, c’est bien l’utilisation du microscope qui donne tout son intérêt à la microchirurgie, à tel point qu’on peut considérer comme relevant de cette technique la suture d’un gros vaisseau. Ainsi, la microchirurgie consiste moins dans une manipulation de structures très fines que dans l’adoption d’un certain état d’esprit, d’un souci délibéré de perfection dans l’accomplissement de l’acte chirurgical. Il sied donc de n’envisager ici comme matériel grossissant que le microscope, qui seul donne à l’intervention microchirurgicale le confort d’une technique éprouvée. Bien que cet instrument existe depuis plus d’un demi-siècle, c’est dans les années soixante qu’il a été assez perfectionné pour prendre sa véritable place en chirurgie. Le microscope de salle d’opération est un appareil binoculaire, monté sur une lourde colonne et rendu mobile grâce à un bras articulé. Le grossissement, variable suivant les types d’instrument, dépend essentiellement de la focale et des oculaires utilisés. Les appareils les plus modernes possèdent une zoom, ou grossissement variable, qui va par exemple de 6 憐 à 40 憐 et qui est manié électriquement, la mise au point s’opérant au moyen de pédales, de telle façon que les mains de l’opérateur demeurent libres. Il est possible d’adapter sur ces microscopes des oculaires pour les assistants, un appareil photographique, voire une caméra de cinéma ou de télévision. Après un certain apprentissage, on peut utiliser de tels appareils pendant des heures, sans en éprouver aucune fatigue particulière. En un mot, ils deviennent indispensables.La coagulation est utilisée en salle d’opération depuis longtemps pour l’hémostase; elle permet au courant de passer entre la pince du chirurgien et une plaque fixée sur le malade. Pour les structures très fines, ce procédé ne convient pas, car il diffuse et peut détruire d’autres structures fines avoisinantes; on utilise alors la pince bipolaire, le courant passant seulement entre les deux pointes de celles-ci; la coagulation est ainsi extrêmement précise et limitée.Les microchirurgiens se servent enfin d’instruments de manipulation. Il s’agissait, au départ, d’instruments de neurochirurgie ou d’ophtalmologie, que certains utilisent encore; cependant, d’autres ont été créés qui répondent plus exactement aux besoins. Les pinces sont restées de banales pinces d’horloger, très fines, simplement polies.Tous les autres instruments sont des instruments à ressort qui adoucissent les mouvements, puisque les seuls mouvements actifs se localisent entre le pouce et l’index. La nouveauté la plus originale a consisté à mettre au point des microclamps vasculaires; il a fallu beaucoup de travail pour en fabriquer qui soient à la fois efficaces et atraumatiques pour de petits vaisseaux de moins de 1 mm. Poussant plus loin, on a pu, par des systèmes parfois compliqués, attacher deux clamps ensemble en leur conservant une mobilité qui permette de rapprocher les extrémités des vaisseaux à suturer.On a fait aussi de grands progrès depuis quelques années, pour les fils de suture, dont le plus utilisé est de nylon 10/0, mesurant environ 25 micromètres, et dont les plus fins ont 18, 15, voire 12 micromètres. Un problème enfin persiste pour les aiguilles, qui sont, elles, beaucoup plus grosses (environ 120 micromètres); toutefois, sur ce point aussi, des progrès récents sont venus perfectionner les matériels existants.La techniqueLorsqu’on dispose du matériel complet, comment suture-t-on par exemple une artère de 1 mm?Les extrémités du vaisseau sont nettoyées et lavées avec du sérum hépariné. Avec les clamps, on rapproche les deux extrémités et la suture commence. On fait tout d’abord deux points à 180 degrés qui serviront de tracteur. Le passage de l’aiguille s’opère avec un grossissement de 15 ou 20, alors que, pour le serrage des nœuds, on utilise le grossissement 6. Ensuite, la face antérieure est suturée par deux ou trois points et les clamps sont retournés, exposant la paroi postérieure du vaisseau, qui est suturée à son tour. Cette anastomose, qui consiste à mettre environ six à huit points séparés, prend de 10 à 15 minutes.Les techniques sont assez semblables pour les sutures veineuses et pour les sutures lymphatiques, mais elles sont différentes pour les sutures nerveuses, car les nerfs sont des structures pleines. Dans ce cas, on suture la tunique (périnèvre) qui enveloppe les fascicules nerveux. Deux points suffisent alors pour affronter des groupes de fascicules, l’objectif étant simplement d’opposer le plus exactement possible les deux extrémités nerveuses.De la chirurgie expérimentale aux applications cliniquesLa microchirurgie demande, pour obtenir la fiabilité nécessaire, un long entraînement au laboratoire. Cet entraînement consiste, pendant des semaines, avant d’entreprendre un protocole expérimental, à suturer les vaisseaux chez de petits animaux (rat ou lapin) qui se prêtent à de nombreuses transplantations; cela présente le double intérêt de la rapidité de l’intervention et de la diminution des coûts de la recherche (par exemple transplantation du cœur, du rein, du foie, de l’intestin chez le rat).Pendant longtemps limitée à ce champ expérimental, la microchirurgie est entrée dans l’ère des applications cliniques, qui bénéficient des enseignements tirés des expériences sur l’animal.Réimplantation digitaleC’est depuis 1965 que la technique de la réimplantation d’un doigt a été progressivement mise au point. Elle se déroule, si l’on imagine les meilleures conditions, de la manière suivante.Dès que le doigt coupé est recueilli, il est placé dans un sac en plastique, lui-même mis dans un autre sac contenant de la glace. Un pansement est appliqué sur la main et le malade est dirigé vers un centre où les réimplantations peuvent être pratiquées. Ce centre peut être éloigné, car, conservé ainsi dans la glace, un doigt peut garder pendant des heures toutes ses aptitudes à la réimplantation. À l’arrivée, le malade est examiné; si les conditions sont favorables et qu’il le désire en toute connaissance de cause, l’intervention commence. Les deux extrémités ayant été préparées simultanément par deux équipes, le doigt est fixé par une broche et l’on suture les tendons, puis les vaisseaux (artères et veines) et les nerfs.Cette intervention difficile et longue (elle dure plusieurs heures) n’est pas possible dans tous les cas: le traitement postopératoire comporte l’administration d’anticoagulants à forte dose que certains malades ne peuvent supporter. Les réimplantations digitales aboutissent à des échecs dans plus de 10 p. 100 des cas. Le doigt réimplanté ne sera jamais complètement normal; dans les cas favorables, il récupère une bonne sensibilité, mais il garde toujours une certaine raideur.On considère que, pour la partie allant du milieu de la main à l’extrémité des doigts, le microscope est indispensable à l’intervention: on est ici dans le domaine de la microchirurgie. Tandis que des réimplantations de la main, le poignet étant une zone limite, ont pu être effectuées avec succès sans microscope. Les problèmes que posent les réimplantations de membres (bras, jambe) sont ceux de la réimplantation en général; ces interventions ne rélèvent pas de la microchirurgie.Les transferts libresCes transferts libres représentent l’application principale de la microchirurgie en chirurgie reconstructive. Ils ont permis de libérer le chirurgien des contraintes des lambeaux pédiculés et ont permis des reconstructions très audacieuses de lésions autrefois sans espoir.Les lambeaux libres . La couverture des pertes de substances profondes est difficile, car les greffes de peau mince n’apportent pas l’étoffe suffisante. Il est nécessaire, pour recouvrir un os ou un tendon, d’apporter toute l’épaisseur de la peau et ce lambeau cutané ne survivra que si sa vascularisation nutritive est conservée ou rétablie. Il était donc nécessaire, dans le passé, de faire migrer les lambeaux d’une zone du corps à une autre, progressivement, au prix de positions désagréables, d’interventions multiples et de plusieurs semaines voire de plusieurs mois. Ces transferts de lambeaux ont été simplifiés par l’utilisation de la microchirurgie. Le pédicule vasculaire nourricier du lambeau est sectionné et sera suturé, au niveau de la perte de substance, à une artère et à une veine locales. L’intervention peut donc être réalisée en un temps. Depuis près de quinze ans, l’imagination fertile des chirurgiens a permis de déterminer près d’une centaine de zones du corps humain où un lambeau et son pédicule peuvent être prélevés sans provoquer de séquelles importantes.Les transferts composés . Un pas de plus a été franchi en transférant non seulement un segment cutané de couverture mais une unité fonctionnelle, par exemple en suturant également le nerf de ce lambeau (lambeau sensible) ou en transférant en même temps que la peau un segment osseux (lambeau ostéo-cutané) ou un muscle (lambeau musculo-cutané).L’aspect le plus sophistiqué de ces transferts est le transfert complet d’un orteil de pied pour reconstruire un doigt. Il faut là, suturer la peau, les tendons, les os et articulations, les nerfs, et bien entendu, les artères et les veines.Ces transferts sont très utiles pour reconstruire la main après une grande mutilation ou encore chez les enfants atteints de malformation congénitale.Les transferts osseux . Les grandes pertes de substance osseuse sont de traitement long et difficile. La microchirurgie permet de transplanter de grands segments osseux avec leurs vaisseaux, assurant ainsi une survie de la greffe et une meilleure consolidation.Les lymphatiquesAucune technique ne permet de manière satisfaisante de traiter le lymphœdème, qui est un gonflement du membre dû à une insuffisance de la circulation lymphatique, insuffisance le plus souvent consécutive à un obstacle. Et, même, beaucoup d’interventions sont esthétiquement mutilantes.Aussi a-t-on récemment pensé à utiliser la microchirurgie pour dériver les lymphatiques dans des veines de voisinage qui drainent la lymphe. Les premières applications cliniques de cette méthode semblent donner des résultats intéressants et laissent présager un renouvellement important du traitement des affections de ce genre.La neurochirurgie vasculaireDepuis 1967, les neurochirurgiens ont appliqué les principes de la microchirurgie vasculaire à la réparation des lésions cérébrales ischémiantes: lorsque les branches proximales de la carotide sont trop atteintes pour être réparées, reste la possibilité d’une revascularisation cérébrale par une anastomose entre une artère extracrânienne (la temporale ou l’occipitale) et une artère intracrânienne située sur le cerveau directement.Cette méthode chirurgicale est en plein développement et se pratique maintenant, dans les cas d’urgence, avec des résultats encourageants.La chirurgie des nerfsDepuis vingt ans, les chirurgiens ont compris l’intérêt du microscope pour la chirurgie des nerfs périphériques. Le nerf est, en effet, constitué de dizaines de groupes de fascicules comprenant des milliers d’axones. S’il n’est pas possible de suturer les axones, on peut du moins suturer individuellement les groupes fasciculaires, ce qui donne plus de précision à la réparation.D’importants problèmes se posent encore à la chirurgie nerveuse, mais les progrès techniques qu’apporte la microchirurgie ont déjà amélioré les possibilités des chirurgiens.Autres applications cliniquesDe nombreuses autres spécialités peuvent ou vont pouvoir bénéficier de la microchirurgie, notamment la chirurgie de la stérilité masculine ou féminine (pour l’opération des trompes, les résultats sont très encourageants), la pédiatrie (aussi bien pour la dissection que pour les opérations vasculaires: certaines interventions de chirurgie cardiaque chez le nouveau-né qui a des malformations), l’urologie, la chirurgie biliaire, la chirurgie vasculaire périphérique, etc., grâce aux méthodes de traitement des images qui sont maintenant possibles.
microchirurgie [ mikroʃiryrʒi ] n. f. ♦ Didact. Chirurgie réalisée sous le contrôle d'un microscope. ⇒ microdissection.
● microchirurgie nom féminin Chirurgie réalisée à l'aide d'un microscope binoculaire permettant de grossir jusqu'à 40 fois la vision du champ opératoire.microchirurgien. f.d1./d CHIR Chirurgie pratiquée à l'aide d'un microscope.d2./d BIOL Micromanipulation à caractère chirurgical.⇒MICROCHIRURGIE, subst. fém.MÉD. Partie de la chirurgie concernant des structures vivantes très petites et effectuée sous microscope. Les progrès de la microchirurgie (chirurgie faite sous microscope) permettent de réimplanter des organes, et surtout les doigts amputés accidentellement (Le Point, 18 juill. 1977, p. 21, col. 2).REM. Microchirurgical, -ale, -aux, adj. Relatif à la microchirurgie. Il en est de même des expériences effectuées sur la sécrétion et la réabsorption de diverses substances au niveau du néphron, qui sont du domaine de la physiologie rénale, même si tous les résultats obtenus l'ont été grâce aux techniques microchirurgicales (Encyclop. univ. t. 10 1972, 1050).microchirurgie [mikʀoʃiʀyʀʒi] n. f.ÉTYM. 1931; de micro-, et chirurgie.❖♦ Didact. Chirurgie des structures vivantes microscopiques; micromanipulation chirurgicale. ⇒ Microdissection. || « (…) seules des transplantations de noyaux de cellules jeunes dans des cellules plus âgées, ou inversement, permettront d'attaquer le sujet sous un angle authentiquement expérimental. Malheureusement, les techniques de la microchirurgie sont actuellement trop grossières pour permettre ce type de manipulation sur les petites cellules de mammifères » (la Recherche, févr. 1974).❖DÉR. Microchirurgical.
Encyclopédie Universelle. 2012.

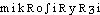 ]. Étymol. et Hist. 1931 (Lar. 20e). Comp. de
]. Étymol. et Hist. 1931 (Lar. 20e). Comp. de